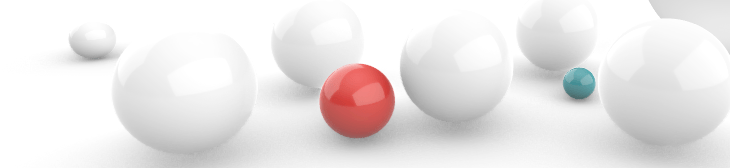Article paru dans la revue Études, oct. 2021
Dans cette relecture saisissante où s’éclairent les mécanismes du déni et de la perversion, s’ouvre une voie de réconciliation entre l’enfant, l’adulte et le religieux qu’il est devenu.
Quelle fut la genèse de ce texte que vous venez de publier, Prière de ne pas abuser (Seuil), dans lequel vous racontez les abus sexuels que vous avez subis durant l’enfance, et qui a un statut un peu particulier dans votre bibliographie de théologien. Avez-vous mis du temps à écrire ce texte ou y a-t-il un événement précis qui en a déclenché l’écriture et qui l’a fait venir ?
Patrick C. Goujon : Je me suis mis d’abord à écrire pour moi, pour ne pas me perdre dans ce qu’il m’arrivait en reconnaissant les abus que j’avais subis. J’avais été complètement dans le déni, dans une forme d’oubli. Quand ces souvenirs me sont revenus d’un coup, cela a été un tel choc que, en entreprenant une psychothérapie et en vivant jour après jour comme une espèce d’épluchage de couches successives, je me suis mis à noter ce qui se révélait à moi de mon histoire, de mon tempérament, de ma manière d’agir, des choix que j’avais faits, parce que tout s’effondrait.
Après, il y a eu une écriture que j’ai pensée en vue d’une publication, une écriture de réflexion qui pourrait s’adresser à d’autres : réfléchir à ce qu’il m’arrivait et à ce dont cela témoigne de processus communs, de blessures, de traumatismes, tout cela en interrogeant ma propre foi. Au départ, je pensais que je ne pouvais pas écrire autrement que sous forme d’éclats. Ce que je vivais, ce que j’avais vécu était déchirant, c’était comme si je me coupais moi-même à ces débris de mon identité, il y avait quelque chose de sanglant. Les premières formes qui venaient, c’étaient des éclats. Mais j’ai finalement trouvé ma voix dans un style plus linéaire, plus classique.
Ce qui m’a poussé à écrire pour d’autres fut la conviction qu’on avait quand même peu idée, dans la société et en particulier dans l’Église, non pas tant de la gravité de ce qui arrive à un enfant quand il subit des abus sexuels, mais de la gravité de ce qui arrive à un adulte quand il a subi enfant des agressions sexuelles. C’est un autre plan, que moi-même je découvrais en le vivant, et qui pour moi était une manière de répondre à des accusations ou à des minimisations qu’on entend en particulier dans l’Église, jetant l’opprobre sur ces victimes quand on se demande pourquoi elles ne parlent que trente ou quarante ans après les faits. Elles ne parlent que maintenant parce que, précisément, les séquelles s’intensifient avec l’âge.
Vous décrivez comment votre corps avait gardé des traces des traumatismes des agressions sexuelles qui se manifestaient par différents symptômes, tous inflammatoires (hernies, inflammations, etc.), mais sans que jamais ces symptômes aient pu être identifiés comme ceux de la souffrance que vous aviez subie enfant. Pourriez-vous rappeler les étapes de cette reconnaissance ?
P. C. G . : Je suis agressé par ce prêtre entre les années 1977 et 1981. J’ai entre huit et onze ans. Quand je suis enfant, je ne sais pas ce qui m’arrive au fond, mais je sens bien qu’il y a des choses qui ne sont absolument pas normales. À l’adolescence, je comprends que ce prêtre se masturbait contre moi régulièrement. À ce moment-là, j’avais conscience d’agressions (sans toutefois user de ce mot), j’avais conscience que ce prêtre était pédophile. Ce n’était quand même pas si tabou qu’on veut bien le dire aujourd’hui. Mes parents m’avaient mis en garde sur le fait que des adultes pouvaient se livrer à des attouchements. Quand j’ai eu dix-huit ans, j’ai demandé des nouvelles de ce prêtre à un autre prêtre de Verdun. J’avais vraiment le sentiment d’un statut particulier de cet homme qui, pendant longtemps, n’avait pas été en paroisse et qui travaillait dans le secrétariat de l’évêché. Quand je le croisais, il avait une espèce de regard hagard. Jamais il ne répondait à mes saluts alors qu’il m’avait connu enfant (c’est le cas de le dire). À ce moment-là, j’aurais aimé qu’on me dise quelque chose qui m’aurait autorisé à parler, mais on m’a fait une réponse plus qu’évasive, on m’a seulement informé de sa mutation. Du coup, sans que j’aie rien décidé, j’ai classé l’affaire.
Cela n’a pas été possible non plus d’en parler à votre famille ?
P. C. G . : Je n’ai jamais pensé en parler à mes parents. Je n’ai jamais pensé en parler à qui que ce soit, en réalité. Et puis ce que ce prêtre m’avait fait ne s’était pas passé comme mes parents m’avaient décrit la manière dont cela pouvait se passer… Du coup, je n’ai pas pu nommer cette agression. Pourquoi ce temps de la reconnaissance fut-il si long ? C’est une question avec laquelle je me suis battu une fois la reconnaissance effectuée. Qu’avais-je donc fait pour ne pas le voir ? J’ai appris à ne plus m’en culpabiliser, parce que c’est évidemment un sujet de honte et d’humiliation pour quelqu’un qui travaille en outre à l’accompagnement des personnes. (suite réservée aux abonnés)